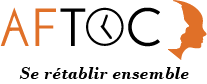Synthèses du Dr Hugues Lamothe
Le Dr Hugues Lamothe est psychiatre à l’hôpital spécialiste des tocs chez les enfants et adolescents, il exerce à l’Hôpital Robert-Debré à Paris.
Le Dr Hugues Lamothe propose régulièrement sur le groupe Facebook de l’AFTOC des synthèses et résultats d’études scientifiques récentes sur le TOC, vos trouverez ici ses synthèses classées par dates.
- 28 Janvier 2024 Taux de rémission à long terme et prédiction du développement dans le trouble obsessionnel-compulsif : Résultats d'une étude de cohorte longitudinale et naturaliste de six ans
- 4 Février 2024 Vérifications excessives dans le trouble obsessionnel-compulsif : la spectroscopie à résonance magnétique à 7 Tesla révèle des corrélats neurochimiques
- 11 Février 2024 Ciblage de l'aire motrice supplémentaire et du cortex préfrontal dans le trouble obsessionnel-compulsif par une stimulation électrique intensifiée à deux doses : un essai clinique aléatoire contrôlé
- 19 Février 2024 La taille du pallidum pourrait prédire de l'efficacité des thérapies cognitives basées sur la pleine conscience et de la psychoéducation chez les patients non-médicamentés atteints de trouble obsessionnel-compulsif
- 26 Février 2024 Efficacité comparée des protocoles de stimulation magnétique transcrânienne répétée pour le trouble obsessionnel-compulsif : Une méta-analyse en réseau
- 3 Mars 2024 Altérations sélectives de l'expression des gènes du système endocannabinoïde dans le trouble obsessionnel-compulsif
- 9 Mars 2024 Comparaison de la gravité de la maladie, de l'anxiété et de la dépression chez des patients atteints de trouble obsessionnel-compulsif et avec différents niveaux de conscience de la maladie
- 8 Avril 2024 Héritabilité chez les jumeaux du trouble obsessionnel-compulsif cliniquement diagnostiqué
"Long-term remission rates and trajectory predictors in obsessive-compulsive disorder: Findings from a six-year naturalistic longitudinal cohort study"
Taux de rémission à long terme et prédiction du développement dans le trouble obsessionnel-compulsif : Résultats d'une étude de cohorte longitudinale et naturaliste de six ans
- Plus le TOC était sévère au départ moins le patient avait de chance d'être en rémission,
- Si le TOC débutait après 19 ans, cela augmentait la probabilité de rémission, ce qui souligne le poids de la génétique dans le TOC de l'enfant/ado
- Plus le patient était agé, plus il avait de chance d'être en rémission, ce qui montre qu'avec le temps on augmente la chance d'être guéri
- Le fait d'être un garçon rend plus probable la rémission, ce qui souligne selon moi le caractère neurodéveloppemental de certains TOC.
Excessive Checking in Obsessive-Compulsive Disorder: Neurochemical Correlates Revealed by 7T Magnetic Resonance Spectroscopy
Vérifications excessives dans le trouble obsessionnel-compulsif : la spectroscopie à résonance magnétique à 7 Tesla révèle des corrélats neurochimiques
Targeting the prefrontal-supplementary motor network in obsessive-compulsive disorder with intensified electrical stimulation in two dosages: a randomized, controlled trial
Ciblage de l'aire motrice supplémentaire et du cortex préfrontal dans le trouble obsessionnel-compulsif par une stimulation électrique intensifiée à deux doses : un essai clinique aléatoire contrôlé
Pallidum volume as a predictor for the effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy and psycho-education in unmedicated patients with obsessive-compulsive disorder
La taille du pallidum pourrait prédire de l'efficacité des thérapies cognitives basées sur la pleine conscience et de la psychoéducation chez les patients non-médicamentés atteints de trouble obsessionnel-compulsi
Dans cette étude, les auteurs ont comparé 16 patients suivant un programme de mindfullness thérapie pleine conscience) et 16 patients recevant une éducation sur leur maladie pendant 10 semaines également. Avant de commencer les thérapies, les patients passaient une IRM.
Il ressortait que les patients suivant le programme de mindfullness s'amélioraient de façon plus importante (YBOCS qui passait de 22 à 10) que ceux ne recevant qu'une éducation thérapeutique (YBOCS passant de 20 à 15). Par ailleurs, les auteurs constataient que les patients présentant un volume pallidal plus important (le pallidum est une région particulière du cerveau) s'amélioraient plus que les patients présentant un volume de cette région moins importante, peu importe la thérapie suivie.
Comme toujours, les résultats sont à prendre avec des pincettes mais montre bien que tous les patients ne sont pas égaux devant les traitements quelques soit leur nature, et leur réponse peut ainsi dépendre en partie de facteurs anatomique comme ici le volume du pallidum.
Bon courage à tous!
Comparative efficacy of repetitive transcranial magnetic stimulation protocols for obsessive-compulsive disorder: A network meta-analysis
Efficacité comparée des protocoles de stimulation magnétique transcrânienne répétée pour le trouble obsessionnel-compulsif : Une méta-analyse en réseau
Dans cette étude, les auteurs ont analysé l'ensemble des études portant sur une technique de stimulation magnétique non invasive (rTMS) et ont regardé l'efficacité de cette technique dans le TOC en fonction de la zone du cerveau ciblé. Il en ressort qu'une stimulation qui mène les neurones d'une région particulière du cortex prefrontale (cortex préfrontal dorsolatéral) est efficace si elle est mené des deux cotés (à droite et à gauche), qu'une sitmulation qui cette fois inhibe l'activité des neurones du cortex préfrontal dorsolatéral est efficace si elle est appliquée seulement à gauche, enfin une stimulation d'une autre région du cerveau (cortex cingulaire antérieur) semble efficace.
Bien évidemment cela dépend des patients, de la nature du protocole (durée des séances, fréquence des séances, capacité à bien cibler les régions souhaitées etc....).
Mais cette méthode avec la tDCS que j'ai présenté il y a quelques semaines peuvent pourquoi pas s'avérer utiles pour certains patients résistants. A suivre.
Selective alterations of endocannabinoid system genes expression in obsessive compulsive disorder
Altérations sélectives de l'expression des gènes du système endocannabinoïde dans le trouble obsessionnel-compulsif
Dans cette étude, les chercheurs ont recherché sur des cellules sanguines circulantes (donc pas des cellules cérébrales, ce qui limite toujours la portée des résultats) ce qui l'en était des gènes impliqués dans le système endocannabinoïde (système impliqué dans des tas de processus différents, tant cognitifs qu'immunologiques). Les auteurs n'ont étudié que 35 patients souffrant de TOC (ce qui est très peu pour une étude génétique) et les ont comparé avec 32 sujets sains.
Les auteurs ont retrouvé que 3 gènes de ce système étaient moins actifs que chez les sujets sains (ce n'est pas précisé mais je présume que cela signifie une moindre importante d'ARNm retrouvé en lien avec ces protéines), et cela était possiblement du pour un de ces 3 gènes à un phénomène épigénétique (disons une modification acquise et non héritée d'un gène).
Il faut garder en tête qu'il ne s'agit ici que d'association, rien ne dit que des différences d'expressions de ces trois gènes aboutissent au TOC, il faut certainement l'implication d'autres mutations encore comme c'est le cas des maladies polygéniques tels que le TOC. Mais c'est intéressant de voir qu'un tel système pourrait être impliqué dans le TOC.
Surtout, quand je lis ce type d'étude, bien que d'impact limité pour les patients (comme la plupart des études, les avancées pour les patients sont lentes, ils faut passer par toutes ces études "inutiles" avant d'en ressortir une avancée concrète), je pense surtout aux parents de patients que je reçois: non, l'éducation n'y est pour rien dans l'écrasante majorité des cas de TOC, il s'agit le plus souvent de malchance, d'un mauvais mélange de gène qui se fait par hasard entre les deux parents et abouti à la maladie. Non vous n'y êtes pour rien, vous n'avez juste pas de chance et il faut maintenant trouver un moyen de réparer cela.
https://www.nature.com/articles/s41398-024-02829-8
Comparison of Disease Severity, Anxiety and Depression in Obsessive-Compulsive Disorder Patients with different Insight
Comparaison de la gravité de la maladie, de l'anxiété et de la dépression chez des patients atteints de trouble obsessionnel-compulsif et avec différents niveaux de conscience de la maladie
Dans cette étude, les auteurs ont regardé les liens qui existaient entre la conscience de la maladie (plus exactement, la conscience que les symptômes du patient proviennent du TOC: "oui je suis certain que je ne mourrai pas parce que j'ai touché la table, je sais que cette crainte vient de mon TOC" -> bonne conscience de la maladie, versus "je suis certain que je vais mourir de contamination si je touche la table, vous dites que c'est un TOC mais moi je suis sûr que c'est vrai" -> mauvaise conscience de la maladie).
Les auteurs ont étudiés 80 patients souffrant de TOC avec une bonne conscience de la maladie contre 31 avec une mauvaise conscience de la maladie. Les auteurs retrouvaient que les patients avec une mauvaise conscience de la maladie avait un TOC plus sévère, et étaient plus anxieux et plus déprimés. De plus, il semble que plus les patients ont conscience d'avoir besoin d'un traitement, moins ils sont sévère.
Au total, tous ces résultats étaient sommes toutes connus et logiques néanmoins ils illustrent combien il est important ce travail de reconnaissance de la maladie, de reconnaissance des pensées obsédantes et de leur réattribution à la maladie et non à des convictions erronées qui sont le propre du TOC (tout le piège est là!).
Je vous souhaite à tous un bon courage,
(et n'écoutez pas trop ce que vous raconte votre tête! La méditation est un bon exercice à long terme pour aider à prendre du recul par rapport à nos mauvaises pensées!)
https://actaspsiquiatria.es/.../actas/article/view/1546/2451
Heritability of Clinically Diagnosed Obsessive-Compulsive Disorder Among Twins
Héritabilité chez les jumeaux du trouble obsessionnel-compulsif cliniquement diagnostiqué
L'héritabilité, pour le dire simplement, est la part du TOC liée simplement à la génétique. Cette étude a porté sur 130.000 jumeaux (vrais ou faux). Elle a montré que la génétique expliquait 50% du TOC des patients.
Cela signifie deux choses: qu'il n'y a pas de TOC sans génétique d'une part car l'héritabilité n'est pas de 0%. Mais cela veut dire également que la génétique n'est pas une fatalité, et c'est important de le comprendre. Pour illustrer cela, prenons les résultats même de l'étude: ils ont trouvé 15 pairs de vrais jumeaux où les deux jumeaux étaient malades mais 199 ou seul un des deux étaient malades, malgré une génétique commune donc! Et c'est effectivement ce que je constate chez les jumeaux que j'ai suivi, ma plupart du temps, un seul est atteint! Pour tous les parents qui liront cela: le TOC de votre enfant est une histoire de malchance: vous pouvez avoir un enfant souffrant de TOC et 25 autres sans TOC... même s'ils sont jumeaux! Et d'autre part vous pouvez voir que l'éducation a peu d'impact car les 50% restant du TOC non expliqués par la génétique sont expliqués par un environnement NON partagé puisque l'éducation est généralement la même pour deux jumeaux.
Au total: pas de culpabilisation dans le TOC de votre enfant! Et si on est patient, idem, rien ne sert de regarder le passé, on ne possède pas de machine à remonter le temps mais on a des armes pour combattre une fragilité! Et très important: pour tout un tas de raisons, génétique ne signifie pas irréversibilité! On peut être diabétique et s'améliorer voire guérir avec l'alimentation et pourtant Dieu sait la part de la génétique dans le diabète!
https://jamanetwork.com/.../jamapsych.../fullarticle/2817090